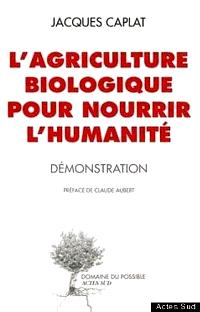 Sur le site de notre excellent confrère Reporterre, un entretien avec l’agronome Jacques Caplat.
Sur le site de notre excellent confrère Reporterre, un entretien avec l’agronome Jacques Caplat.
“L’agriculture biologique peut nourrir le monde”
mardi 4 mars 2014
L’agriculture biologique n’est pas une aimable fantaisie de bobos en mal de verdure, mais une démarche apte à sortir l’agriculture européenne de l’impasse dans laquelle elle se trouve. Enjeu : nourrir neuf milliards d’habitants. Moyen : changer de paradigme, et sortir de la subvention aux machines. Entretien bousculant avec l’agronome Jacques Caplat.
L’agriculture biologique pourrait alimenter neuf milliards d’êtres humains et être plus productive que notre agriculture conventionnelle. C’est l’idée iconoclaste défendue par Jacques Caplat. Il est agronome, ancien conseiller agricole, fils d’agriculteur et auteur d’un ouvrage intitulé L’Agriculture biologique pour nourrir l’humanité (Actes Sud). Il y démonte les idées reçues sur l’agriculture biologique et rappelle que notre agriculture occidentale contemporaine n’est pas le seul modèle possible.
Reporterre – Voici peu, nous révélions qu’un collectif de scientifiques conteste le grand rapport de l’INRA (Institution national de recherche agronomique) sur l’agriculture biologique. Qu’est-ce que cela vous inspire ?
Jacques Caplat – Cette affaire témoigne du retard de l’INRA en matière de bio. L’INRA est une institution encore bloquée. Ceux qui ont signé cette lettre savent qu’au sein de cet institut quand on l’ouvre, ce n’est pas une bonne chose pour sa carrière.
Mais cela va encore plus loin. Le fait que dans un rapport prétendument sérieux, ils aient pris en compte le pamphlet d’un lobbyiste [Gil Rivière Wekstein, Le bio, fausses promesses et vrai marketing, Le Publieur éditions, 2011 – NDLR], pose un vrai problème de fond. Dans la plupart des centres de recherche dans le monde, si une structure ose mettre dans ses références un pamphlet politicien comme celui-là, c’est un discrédit complet et immédiat. Je ne peux pas prendre l’INRA au sérieux après un rapport comme ça.
La direction de l’INRA dit investir dans la recherche sur l’agriculture bio… Mais elle n’a jamais mis un centime de plus. Les rares travaux sur la bio à l’INRA ont quasiment tous été réalisés par des francs-tireurs. La direction de l’INRA est méprisante et désinvolte sur ce sujet.
Le Salon de l’agriculture vient de s’achever : que représente ce grand événement annuel, pour vous ?
Le Salon de l’agriculture est une opération de communication de l’agriculture conventionnelle et de l’agroalimentaire vis à vis du grand public.
Le salon donne au grand public une image fantasmée de l’agriculture : champêtre, sympathique, de terroir et proche des gens. L’entretien de ce mythe est un des fers de lance du mensonge autour de l’agriculture française. On cache sa vraie nature pour que le grand public ne se mobilise pas contre. On constate lors de chaque scandale sanitaire, ou sur les pesticides, que le grand public ne veut pas de l’agriculture telle qu’elle est aujourd’hui. Si l’agriculture était telle qu’on la voit au salon, ce serait génial !
Au milieu de cet immense salon, on trouve un petit stand dédié à l’agriculture biologique : est-il représentatif de la place de la bio en France ?
Cela représente la place de la bio au sein du monde agricole : minime. Si l’agriculture voulait vraiment laisser une place à la bio, celle-ci devrait être présente dans chaque partie du salon. Actuellement, il n’y a qu’un espace bio en un point donné, et quelques comme si c’était pittoresque.
Dans la préface de votre ouvrage, l’agronome Claude Aubert explique que l’agriculture conventionnelle ne peut pas nourrir le monde. Pourquoi ?
L’agriculture conventionnelle a été conçue en Europe pour l’Europe. On a un peu tendance en Europe à penser que l’agriculture, c’est notre agriculture. Mais il y a mille agricultures possibles. En Asie et en Amérique Latine, l’agriculture s’est construite autour des cultures associées. En Europe et au Moyen-Orient, elle s’est construite autour des cultures pures, telle que dans un champ de céréales, il y a une seule plante. Même les élevages sont spécialisés.
On a construit un système de sélection des semences uniquement basé sur le rendement, qui a totalement coupé les plantes de toute interaction avec le milieu : on se débrouille pour qu’il n’y ait pas le moindre animal ni la moindre maladie dans le champ.
Ensuite, ces plantes sont mises en culture. Si on les mettait dans la nature telles quelles, elles mourraient sans doute. Donc pour pouvoir les cultiver on est obligé de mettre énormément d’engrais et de pesticides afin de se rapprocher des conditions de la sélection.
De plus, les cultures pures permettent la mécanisation, ce qui supprime des emplois. A la fin de la seconde guerre mondiale, c’était considéré comme un avantage car cela permettait de libérer des bras pour reconstruire l’Europe – mais on n’est plus du tout dans cette problématique.
Donc, le système conventionnel c’est cela : des variétés sélectionnées complètement irréelles, que l’on cultive avec des engrais et des pesticides chimiques, dans un système très mécanisé. Le problème de ce modèle est qu’il demande que l’on reproduise au champ les conditions idéales de la sélection. C’est possible dans les milieux tempérés. Mais les trois quarts de la planète ne sont pas tempérés. Et c’est la grande imposture de l’agriculture conventionnelle quand elle a voulu se généraliser à l’ensemble de la planète sous le nom de “Révolution verte” : on a développé une agriculture conçue dans un contexte particulier et on l’a appliquée au monde entier.
Je suis effaré d’entendre des gens dire que le riz amélioré en Inde fait dix tonnes par hectare. Les paysans indiens que je connais ne font en moyenne que trois tonnes par hectare en conventionnel. Effectivement, les bonnes années, ils sortent dix tonnes. Mais deux années sur trois sont mauvaises… Et ces années-là, ils ne produisent qu’une tonne par hectare parce que, quand ça ne marche pas, ces variétés conventionnelles, ça ne marche vraiment pas…
Donc ce système ne peut pas nourrir la planète. C’est pour cela qu’il y a entre 800 millions et un milliard de personnes qui souffrent de la faim dans le monde.
Votre ouvrage dénonce les idées reçues sur l’agriculture biologique. La plus répandue est sans doute que la bio serait juste une agriculture sans pesticides…
Si l’agriculture bio consistait simplement à supprimer la chimie, elle serait incapable de nourrir le monde. Si on garde l’agriculture conventionnelle, les variétés sélectionnées pour la chimie, des champs sans écosystème en culture pure, et que l’on enlève seulement la chimie, cela ne va pas être performant.
Alors qu’est-ce que l’agriculture bio ?
Il s’agit de remettre de l’agronomie dans l’agriculture. Le premier livre sur la bio (Fécondité de la Terre, par Ehrenfried Pfeiffer, publié en 1937) l’a définie comme la constitution d’un organisme agricole. C’est-à-dire en mettant en relation l’ensemble des éléments constituant une ferme. C’est un changement considérable, une démarche systémique, alors que la démarche européeenne était réductionniste.
Au lieu de se battre contre le milieu, l’agriculture biologique se sert du milieu. Un des points de départ est d’avoir des variétés ou des races d’animaux adaptées au milieu, qui doivent pouvoir y évoluer.
Deuxième élément fondamental : arrêter de partir des cultures pures qui sont le mode de production le moins performant du point de vue agronomique et chercher plutôt des cultures associées, c’est-à-dire plusieurs cultures sur la même parcelle, ensemble ou en rotation.
Mais l’agriculture bio ne perd-elle pas en performance ?
En Europe, on croit que la bio est moins productive que l’agriculture conventionnelle, parce que l’on ne sait pas les comparer. Aujourd’hui les protocoles prennent une variété de blé conventionnel sélectionnée pour la chimie et la mécanisation. Puis pour le bio ils prennent le même blé qui va être cultivé en culture pure sans chimie : ce n’est pas un protocole de comparaison conventionnel-bio, c’est un protocole de comparaison conventionnel-conventionnel sans chimie. Dans ce cas, les rendements en bio sont forcément inférieurs.
Comment pouvez-vous affirmer que l’agriculture biologique peut nourrir l’humanité ?
Dans le système contraint de l’Europe aujourd’hui, on a peu de variétés adaptées à la bio et on connaît mal le système des cultures associées. On part donc d’un système peu performant en bio.
Mais même dans ce cas, les études à l’échelle planétaire (1) indiquent que si l’on transformait l’agriculture mondiale en bio, les rendements globaux augmenteraient. On perdrait entre 5 et 20 % en Europe et au Canada, mais on augmenterait de 50 à 150 % dans le reste du monde (aux Etats-Unis le rendement de la bio égale celui du conventionnel). Donc même en ne se remettant pas vraiment en cause en Europe, passer en bio à l’échelle planétaire permet de nourrir neuf milliards d’êtres humains.
Mais il faut aller plus loin. Passer en bio en Europe signifie-t-il juste supprimer la chimie ? Non, je vous l’ai déjà expliqué. On peut être plus performant en bio qu’en conventionnel.
Par exemple, l’école d’agronomie de Rennes a mené une étude sur la surface nécessaire pour nourrir la métropole de Rennes. Première hypothèse, le scénario tendanciel : consommation actuelle et agriculture conventionnelle. Ils en déduisent qu’il faut cultiver un anneau de 15 km au delà des limites de Rennes pour nourrir la métropole. Deuxième scénario, on passe en bio, on fait un peu d’agriculture urbaine et on consomme moins de viande – car de toutes façon bio ou pas bio notre système carné occidental n’est pas généralisable à la planète. Dans ce cas, il suffit d’un anneau de huit km autour de Rennes pour nourrir la ville. C’est quasiment deux fois moins de surface en bio qu’en conventionnel.
Quelles décisions faut-il prendre au niveau politique pour développer largement l’agriculture bio ?
Certains pays évoluent déjà vers la bio, comme l’Etat du Kerala en Inde ou encore le Bhoutan. Il y a également beaucoup d’initiatives de communautés paysannes aux Philippines, au Brésil, en Amérique centrale… Ce n’est pas forcément labellisé, mais ils s’engagent dans cette démarche. Mon espoir est que ces exemples fassent tâche d’huile.
En France, si l’on veut que ça bouge, il y a quelques éléments clés.
D’abord, un problème jamais abordé est celui de la fiscalité du travail. La bio utilise plus de main d’oeuvre et dans un monde de chômage de masse, on nous renvoie cela comme un handicap ! Aujourd’hui pour un euro de salaire, un agriculteur doit payer un euro de charges en plus. Alors que pour un euro d’investissement dans des machines, il a 50 centimes de subvention. Le travail coûte quatre fois plus cher que les machines, c’est une distortion de concurrence considérable ! Si on veut développer la bio, il faut changer la fiscalité du travail.
Ensuite, les paysans hésitent à passer en bio parce qu’ils ont peur. Il y a une peur technique, parce que passer en bio c’est apprendre un nouveau métier. Ensuite il y a une peur sociale parce que quand un agriculteur change de technique, il change de réseau social : il ne travaillera plus avec les mêmes personnes. C’est très déstabilisant. Donc il est important de créer des passerelles entre les différents réseaux, de décloisonner la bio. La troisième peur est économique. Vais-je gagner ma vie en bio ? Vais-je trouver des filières où vendre mes produits ?
On peut répondre à ces peurs, mais cela demande une politique volontariste. De l’investissement dans la formation, dans des accompagnements et dans la recherche pour améliorer les techniques de la bio.
Le ministre de l’agriculture Stéphane Le Foll prône l’agro-écologie et dit vouloir rendre l’agriculture française plus durable. Qu’en pensez-vous ?
L’agroécologie c’est un terme ambigu, car il a deux sens opposés. D’un côté tout un groupe de personnes utilise ce terme d’agro-écologie depuis les années 1980, comme Pierre Rhabi, pour parler de la bio la plus aboutie et se distinguer de l’idée que la bio c’est juste enlever la chimie.
A côté de cela, il y a cette agro-écologie réinventée par Stéphane Le Foll ou l’INRA, qui est une démarche de scientifiques, pas d’agriculteurs, consistant à appliquer à l’agronomie les connaissances de la science écologique. C’est un mieux, cela rapproche des techniques de la bio. Mais le problème de cette approche, c’est qu’elle n’est pas globale. Elle ne pose pas la question des semences adaptées au milieu, du social, de l’économique, etc. Si cette agroécologie version Le Foll est conçue comme une transition vers la vraie bio, c’est bien. Si elle est conçue comme un but, c’est totalement insuffisant, car on perdrait de vue la nécessité de remettre à plat le système.
– Propos recueillis par Marie Astier
Notes :
(1) Etudes sur les possibilités de la bio à l’échelle mondiale :
. rapport d’Olivier de Shutter, rapporteur spécial des Nations Unies pour le droit à l’alimentation : Agroécologie et droit à l’alimentation
. Pretty Jules et al., « Resource-Conserving Agriculture Increases Yields in Developing Countries », Environmental Science and Technology, 2006.
. Pretty Jules, « Lessons from certified and non-certified organic projects in developing countries », in Organic agriculture, environment and food security, FAO, 2002.
. UNEP (United-Nation Environmental Program), Organic agriculture and food security in Africa, 2008.
. Badgley Catherine et al., Organic agriculture and the global food supply, Renewable Agriculture and Food Systems, Cambridge University Press, 2007.
. Halberg Niels et al., Global Development of Organic Agriculture : Challenges and Prospects, DARCOF, 2006.
A lire : L’agriculture biologique pour nourrir le monde, Jacques Caplat, éd. Actes Sud, 2012, 480 p., 24,40 €.
