Chapitre II
Nous republions cette étonnante analyse de Pierre Lieutaghi, parue dans Le Sauvage, n° 71, été 1980 . A sa relecture nous avons été stupéfaits de la qualité de sa vision prémonitoire. Rarement un texte manifeste une telle force, même si l’on y rencontre quelques obscurités. C’est pour nous un texte fondateur.
Les Sauvages associés
Pour en finir avec la famine, la guerre, l’économie de marché, le technocratisme giscardien ou rocardien, la pollution, l’industrie, le chômage et le reste, il faut envisager la solution jardin
Il n’y a que deux façons de gérer la planète. L’une mène au jardin. L’autre à l’usine. L’une à la multiplication de la vie, l’autre à la consommation de la vie.
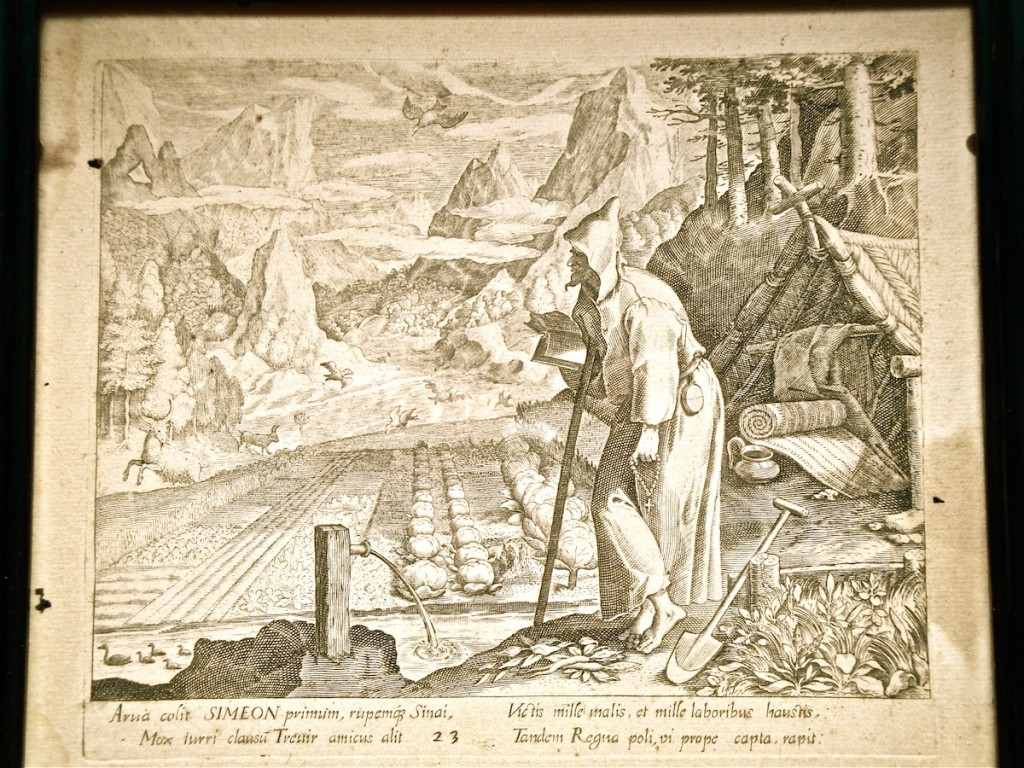 Le jardin, c’est l’unité écologique de base. La cellule normale de la Terre humanisée. Ce n’est qu’à l’échelle du jardin, c’est-à-dire de l’écosystème complice, sol vivant étroitement associé à l’arbre et à l’animal, qu’un rapport à double sens est possible, bénéfique au milieu et à son gestionnaire humain.
Le jardin, c’est l’unité écologique de base. La cellule normale de la Terre humanisée. Ce n’est qu’à l’échelle du jardin, c’est-à-dire de l’écosystème complice, sol vivant étroitement associé à l’arbre et à l’animal, qu’un rapport à double sens est possible, bénéfique au milieu et à son gestionnaire humain.
Le jardin dont il est question ici n’appartient pas aux normes du loisir. Ce n’est pas l’espace-tampon entre le réel (la ville) et le mythe (le sauvage). C’est le lieu d’un échange en profondeur, d’une symbiose, la rencontre de l’intelligence des sens du vivant et des énergies du sol et de la végétation. La représentation graphique de cette symbiose sur la Terre, c’est l’espace jardiné. Tout le reste, sous dépendance humaine, est déséquilibre. Le jardin, cellule verte à multiplier la vie, peut seul restaurer le visage de la Terre, lui assurer une jeunesse pratiquement éternelle.
Le champ sous dépendance industrielle, lui, c’est l’extension aberrante d’un corps étranger, sinon hostile, au devenir de l’ensemble vivant : le domaine urbain. Aberrante parce que soumise et déterminante à la fois. La ville vit de la production du champ. Le champ de celle de la ville (les engrais, les pesticides, les machines, le crédit, le marché, le pétrole). L’ « ordre éternel » du premier ne repose plus que sur la fragilité de la seconde. Un blocus pétrolier, et les blés pourrissent sur pied, les chaumes passent à la friche ; c’est la disette en Occident, sinon la famine. Des agronomes ont étudié la réponse de nos « meilleures terres à blé » à la suppression totale des engrais d’origine industrielle : dans certains cas, les rendements chutent de 70 % à la première récolte. Et de crier évidemment à l’impéritie de ceux qui prônent l’organique !
Autonomie écologique
Au niveau de l’espace jardiné, qui peut presque entretenir son sol de soi-même, et du champ intégré à un écosystème rural complexe, équilibré, où l’herbe, l’animal, l’arbre et la haie s’accordent, la production est d’abord affaire d’intelligence. La gestion du milieu vivant producteur de vie appartient entièrement à ceux qui y vivent. La notion même d’autonomie devient écologique. Le chêne de la forêt ne doit rien à l’usine. À terme, l’espace jardiné est écologiquement auto-suffisant, ou presque. Encore faut-il se défier des a priori stupides : produire avec la vie ne doit pas signifier produire moins sous prétexte de respect des « lois du milieu ». Le modèle médiéval, qui inspire secrètement certains mangeurs de grains et de racines, induirait au mieux une économie de survie. Le propos est d’enrichir le présent, non de lui demander encore l’aumône de sa vie menacée. La Terre sollicite des gestionnaires lucides, savants au sens le plus noble du terme, non une nouvelle race de singes satisfaits de fromages racornis et de pois chiches assaisonnés de quelque mystique masticatoire.
C’est bien une science de la Terre qu’il s’agit de développer, qui ne jettera pas plus l’anathème sur le minéral que sur l’organique. Une intelligence des êtres, des rapports, des équilibrés, des ruptures. Une application, enfin, du savoir accumulé depuis des siècles sur la vie et qui, par quel détournement, lui fait presque toujours obstacle. C’est dans l’espace jardiné, le seul où l’économique, l’humain, peuvent s’intégrer et progresser sans bouleversements, que l’intelligence doit maintenant trouver, prouver sa maturité. Démarche scientifique, parce qu’il est grand temps de se reconnaître adultes dans la complexité du vivant, mais qui ne fera pas plus la part à la biologie ou aux mathématiques qu’à l’intuition contemplative. Le jardin est capable d’équilibre dans la durée. Il est bien plus producteur que le champ[1]. Il nous propose un modèle à comprendre et à propager, une politique de la Terre auprès de laquelle les politiques actuelles tiennent, au mieux, du balbutiement. Y compris les tristes frétillements écologiques au bout des laisses du pouvoir.
En face, les Beauces, le grand réacteur des monocultures intensives, irréductible à toute décentralisation, maîtrisable seulement dans le contexte technocratique. Dans leur rapport avec la Terre, les sociétés de puissance optent, elles, pour la simplification à outrance. La visée est d’abord économique, seulement économique. Il s’agit de tirer parti au maximum, en échange d’un simulacre de restitution qui octroie un supplément de bénéfice : engrais industriels indexés au cours du pétrole. Entre l’usine d’engrais et l’hypermarché, le champ devient presque incongru. En toute logique technicienne, on devrait finir par s’en passer, et c’est bien ce qui s’annonce avec les viandes de synthèse et les cultures hydroponiques en atmosphère contrôlée.
La vie en friches
L’arasement du bocage de l’Ouest, la destruction des cultures vivrières jardinées du Tiers-Monde au profit des productions de masse convertibles en dollars, illustrent, si besoin est, la fonction radicalement anti-vie du champ sous dépendance industrielle. Anti-vie parce que pro-pouvoir. La vie n’est capitalisable que dans ses propres cycles. Réduite à un système producteur de biens détournables, elle régresse dans les bilans de base. Pendant que les statistiques réjouissent les ministères. Pendant que les hommes qui participaient des équilibres initiaux passent à la friche : la production agricole de masse induit nécessairement le bidonville ou la cité-dortoir. Le modèle-jardin, seul, implique le contraire.
La production agricole de masse, c’est la terre sans hommes. Ou alors simples saisonniers, déplacés, main-d’œuvre sans partie prenante dans son lieu d’exploitation (à double sens) : vendangeurs du Languedoc, coupeurs de canne cubains, tziganes cueilleurs de cerises en Provence. On perd son jardin mais on gagne son transistor. Ou sa voiture, question de latitude. Étape nécessaire vers la culture. Amorce des grands chambardements économiques. Fantasme initial des diplômés d’économie politique rêvassant aux marchés encore ensommeillés des pays en voie de. C’est dans le contexte urbain que s’écoulent les biens secondaires issus de la fructification (si possible sous licence occidentale) des produits agricoles convertibles. Petit Indien deviendra grand si ITT lui donne la vie. « Je ne pas parle pas à des gens qui gagnent moins de 300 $ par mois », me disait un ingénieur, grande école, 10 ans d’expérience, fonceur, agressif, constructeur d’équipements lourds outre-mer. Non, les jardiniers ne sont pas des interlocuteurs valables. Sauf pour la Terre.
Comme on ne peut pas semer directement des graines d’automitrailleuses ou de téléviseurs, on fait d’abord un assolement de café ou de canne à sucre. Le maïs, c’est la forme de jeunesse du bifteck et de l’escalope de dinde. 70 % de la production française de céréales finit en viande, avec une perte énergétique de 500 à 1 000 %. On ne cultive plus la terre, mais des pépinières de pouvoir. L’agronome prétend avoir souci du monde et de sa faim. Il exhibe ses tonnages sans jamais mettre en balance le déficit écologique, humain, ni surtout le gigantesque détournement de vie dont il est responsable. La sous-alimentation d’Asie, d’Afrique ou d’Amérique du Sud, n’a rien à voir avec l’Ukraine, la Beauce ou le Middle-West. La Russie n’a nul besoin du blé américain, pas plus que du sucre cubain. C’est l’appétit de viande occidental qui crée la pénurie de soja. La faim, c’est le témoin que se passent les meilleurs coureurs dans la course de relais des nations dominatrices. Il fallait en faire un problème extérieur aux pays qui en souffrent pour leur proposer des solutions extérieures, c’est-à-dire de dépendance.
Le jardin, c’est par excellence la solution intérieure, l’approche responsable, non du phénomène faim, mais de ce qui précède : la gestion désordonnée des terres, l’économie sous tutelle, le mensonge des banquiers à face d’agronome. Le jardin ne prétend pas avoir souci du monde. Il est la représentation d’un monde soucieux de soi-même, l’accord entre tous les dialectes de la terre et les groupes responsables qui sauront les comprendre ou devront se résigner à la stagnation. L’espace jardiné, c’est la grille à promener sur le texte obscurci, délavé, brûlé, de la Terre, jusqu’à découvrir les mots qui amorceront le seul sens d’avenir.
Quelle est la vraie demande de la Terre ? Retrouver un visage, son visage, son souffle, sa voix, sa liberté qui ne finit pas où commence la nôtre mais qui se confond avec la nôtre. Que demandons-nous ? La même chose. Nous ne pouvons plus nous comprendre que dans la compréhension globale du vivant. Cela nous le savons, désormais. Et que l’équilibre des milieux vivants croît dans le même sens que leur complexité. Pour commencer, ne faut-il donc pas échapper à tous les modèles simplificateurs, viser d’emblée ce qui se rapproche le plus de l’impossible, c’est-à-dire de ce que la vie réalise d’elle-même ?
Il faut recomposer la face de la Terre. Rien que ça. Retracer le seul puzzle possible, celui qui reconnaît l’existence du plus grand nombre d’entités, d’espaces susceptibles d’autonomie biologique. Apprendre à lire la Terre comme un livre et non comme une affiche. Un livre de sens jamais figés. Aux quelques plans exclusivement spéculatifs des entreprises de pouvoir, il est encore temps d’opposer les innombrables plans du monde, quand on les aura levés, commentés, compris. La carte de l’avenir, c’est celle de ses jardins possibles. Il faut identifier tous ceux de la Terre, et certains s’y emploient déjà. Trouver pour chaque cellule sa dynamique spécifique, et ses connexions optimales, non soustractives, avec les autres.
Désurbanisons
Le présent devant nous. Une immense étendue de jardins à tracer, à peupler avec des idées, des théories s’il en faut, des plans au moins aussi compliqués que ceux de la plus simple des associations végétales, des capitaux autant qu’on pourra en détourner (la misère n’est pas fertile), des milliards de jeunes arbres et d’arbrisseaux (merci, Soltner, pour ta rage de planteurs de haies ; elle nous gagne), des tracteurs aussi longtemps qu’ils rouleront, des chevaux, des vaches, des zébus, des rennes, un savoir du monde remis à neuf chaque matin, jamais assoupi. Et aussi dans une lutte sans merci non seulement contre la poursuite de l’urbanisation, mais pour la désurbanisation, pour le retour à la Terre, qui doit s’entendre ici comme départ avec.
Dès maintenant, faire les cartes de tous les jardins possibles, région par région, vallée par vallée, partout. Les repérer là où les masquent les maïs, les melons sous plastique, les vergers sous lindane, les pré-pommes frites. Montrer la vie réelle du monde, la face cachée du champ. Les exprimer en termes de base, essentiels : combien cette vallée peut-elle nourrir vraiment de gens ? Quels végétaux, quels animaux, quels types d’énergie, quelles activités secondaires peuvent-ils s’intégrer à l’écosystème potentiel ? Au besoin, l’ordinateur : pourquoi servirait-il uniquement à gérer la dilapidation ?
Faire le relevé attentif de toutes les particularités naturelles, humaines, économiques de chaque entité écologique. Examiner à fond ses possibilités d’évolution spécifique, après y avoir posé le réseau directeur de l’écosystème jardiné, dont la maille varie avec les climats, les sols, les latitudes, les cultures. Traduire la Terre du silence où on la tient depuis des millénaires. Enseigner ses paroles. Lancer des expériences-témoins pour tester la validité des propositions retenues. Et qu’on ne parle pas de difficultés de fric : si nous ne sommes pas capables de consacrer une part de nos biens à l’achat de terres, de matériel, le plus clair de nos idées « écologiques » à la création de groupes de recherches et d’expérimentation, à la vie, à la vraie lutte pour la vie, qu’on se hâte d’accrocher ça où il se doit, déchiré en quatre.
Il y a la Terre à jardiner. La vie n’a que faire de nos larmes, de nos remords. Elle nous demande maintenant de distribuer ses cartes en forme de jardin, et qu’on cesse de s’y perdre dans leur jeu du désert. Si vous avez une mise à faire, votre propre sachet de graines d’avenir, dites-le vite.
Pierre Lieutaghi
[1] En haute Provence, près de Forcalquier, une terre de 6 ha nourrit actuellement, et bien, cinquante personnes. Une partie de la production — sur culture à base organique — est commercialisée.
